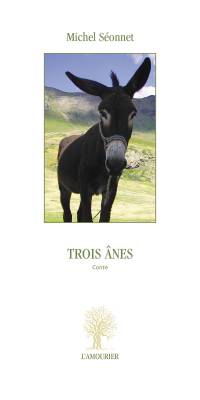Entretien avec Michel Séonnet
Conduit par par Benjamin Taïeb pour la gazette Basilic
Michel Séonnet est né à Nice en 1953. Il a fait ses études au lycée Masséna et son Bleu du galet, publié en 2004 aux éditions Point de Mire, témoigne de son attachement à cette ville.
Michel Séonnet est un écrivain polygraphe : il écrit des pièces de théâtre, des scenari, des essais, des albums pour la jeunesse. Ses romans et autres récits sont publiés aux éditions Verdier, Gallimard et L’Amourier.
Préoccupé par la question de l’intégration sociale, il anime de nombreux ateliers d’écriture dans des milieux réputés difficiles ou dits marginaux, exclus du travail, du corps social, ceux qui sont et vont sans mots et donc souvent sans clé, sans liberté.
Son écriture s’efforce de faire brûler ce feu-là !
Un quatrième ouvrage vient d’être publié aux éditions L’Amourier, Le Pays que je te ferai voir, un roman qui invite au dialogue entre les deux rives de la Méditerranée…
Benjamin Taïeb :
Quels sont les chemins qui t’ont conduit à l’écriture de ce livre : Le pays que je te ferai voir ?
Michel Séonnet :
À dire vrai, je ne sais plus si ce sont des chemins qui ont conduit à ce livre ou si c’est ce livre qui a ouvert des chemins. Bien sûr, mon voyage au Maroc, en 2006, a été décisif. J’y suis allé pour rendre visite, dans leur village, à des anciens soldats marocains de l’armée française que j’avais déjà rencontrés en France, à Beauvais, et sur lesquels, avec mon camarade photographe Olivier Pasquiers, nous faisions un livre (Oubliés de guerre, éditions Créaphis). Je m’étais déjà, à plusieurs reprises, intéressé aux combattants maghrébins de l’armée française. Il en était question dans La Tour sarrasine. Il en serait question dans Trois ânes. Je crois que plus que d’une époque, plus que d’événements historiques, il s’agit pour moi d’un territoire d’écriture où se croisent mon questionnement sur la deuxième guerre mondiale et celui sur le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Pour La Tour sarrasine, j’avais été saisi par cet entrelacement des va-et-vient et des époques entre la France et l’Algérie (croisades, incursions sarrasines, guerre mondiale, guerre d’indépendance, guerre civile algérienne). Avec les anciens combattants marocains, c’est la répétition des recrutements qui m’a requis : pour la guerre, pour les usines, pour la migration clandestine. En France, j’avais travaillé à plusieurs reprises avec des migrants clandestins. D’une certaine manière, le dispositif du Pays que je te ferai voir me permettait de convoquer simultanément ces différents trajets. De tenter, en les faisant se croiser, d’éclairer les uns par les autres. D’essayer de faire voir quelque chose du monde dans lequel nous vivons. La littérature sert à ça, non ?
C’est seulement une fois que j’ai eu en tête ces différents questionnements que j’ai eu besoin de leur donner de la chair. Qu’ils deviennent vies, images, sensations. J’ai commencé par un travail de recherches aux archives militaires du Fort de Vincennes. Puis je suis parti à Oujda qui me paraissait être la ville idéale pour déployer ces entrecroisements d’histoires et de vies. J’y suis revenu une deuxième fois car il me manquait des éléments d’écriture. Je n’avais pas assez regardé la ville elle-même. J’ai besoin d’avoir vu pour écrire.
Je ne sais plus vraiment comment le personnage de Louise est arrivé au milieu de tout cela. “Louise Laugier" avait déjà été une sorte de double dans le premier roman que j’ai publié (Que dirai-je aux enfants de la nuit ? – Verdier). Elle est sans doute venue à cause de mon obsession à raconter des vies où histoire personnelle et histoire collective se croisent et s’induisent l’une l’autre. M’intriguait de lui donner le même nom qu’à celle de Que dirai-je. Deux versions de moi-même ? Je me le suis demandé. Que son père ait disparu en Indochine renvoyait aussi à mon histoire personnelle puisque, alors qu’il était en prison après la guerre, mon père avait demandé à partir en Indochine comme on le proposait aux anciens de la Division SS Charlemagne. Mais seuls ceux qui avaient fait en Allemagne l’école des cadres y avaient droit. Les autres restaient en prison. Un de ses amis y était parvenu qui, par la suite, avait fait toute sa carrière dans l’armée française. J’étais très lié avec ses enfants. Dont un, compositeur, chanteur, musicien, est mort du sida la même année que mon père. Il était homosexuel. Est-ce pour cela que dans le livre Louise l’est aussi ? L’étrange, c’est que je n’ai jamais décidé qu’elle le fût. Elle l’était. Le récit me l’a apportée ainsi.
Benjamin Taïeb :
Est-ce que tu peux revenir sur ce titre, invite au voyage, tiré d’un verset de la Genèse ?
Michel Séonnet :
Il n’y a de voyage qu’intérieur, n’est-ce pas ? C’est en tout cas ainsi que je lis la double traduction possible de la parole dite à Abraham par l’Éternel : Pars / Va vers toi-même. Dans de tels voyages, le déplacement géographique est la marque de l’incarnation qui nous fait êtres vivants. Nous sommes des corps mouvants. Parfois l’âme suit. Ou bien la mobilité, le déplacement, l’exil ou l’exode, sont manières de marcher à sa poursuite. Comme une marche à l’étoile. Ici, ce qui me plait, c’est la polysémie de cette parole. Qui vaut pour chacun des personnages. Pour Louise. Pour son père. Pour Ali, le goumier. Pour son fils mort noyé en traversant la Méditerranée comme pour tous les migrants cherchant à passer à en Europe. Il y a chez tous un rêve de voir “ce pays" qui, dans la tradition biblique, est la “terre promise". Il y a sans doute aussi l’incontournable question pour chacun de trouver “sa" terre, son être au monde, une sorte de justesse sinon de vérité de sa vie. Sans le savoir, c’est sans doute après cela que Louise s’est élancée. Elle cherche dans le passé, dans l’histoire, mais c’est la question de sa place aujourd’hui, de sa place à venir et, au delà d’elle, de la place, de l’existence d’une possible filiation. Elle est “fille de". Mais plus elle avance, plus la question qui se pose pour elle est celle de ce qu’elle va pouvoir enfanter, mettre au monde. Seulement des vies d’oliviers ? Ou aussi des vies d’hommes ?
Benjamin Taïeb :
Il y a beaucoup de rythme dans ces longues phrases, comme une urgence à dire, et en même temps une réflexion du narrateur, au fil de la plume, qui cherche le mot juste, s’interroge, manière de raisonner comme l’eût fait Claude Simon. C’est un écrivain important pour toi, Claude Simon ?
Michel Séonnet :
On dirait qu’aujourd’hui un certain style d’écriture appelle chez le lecteur cette référence à Claude Simon. Pour beaucoup, et particulièrement chez certains “grands" éditeurs nationaux, c’est une manière négative de qualifier une écriture dont le récit, l’histoire, n’est pas le principal souci. L’anecdote historique est pour moi une matière qu’il s’agit de creuser. De là ce besoin épuisant de toujours chercher à dire plus, mieux, à tenter de livrer sur la feuille la “chose-même", l’arbre, la pierre, la femme, et pas seulement une fugitive vision, l’enchaînement des gestes. Il y a quelque chose de physique dans l’acte d’écrire. Creuser. Malaxer. Faire apparaître. Le sentiment qu’il faudrait des pages et des pages de ce traitement pour approcher “la réalité". En ce domaine, je m’auto-limite. Au premier jet, les pages sortent comme des blocs compacts, sans passages à la ligne. L’impression qu’il faut que ça fasse bloc pour que ça tienne. Pour que les phrases ne s’écroulent pas sur elles-mêmes. Après, je fais effort pour poser quelques escaliers, des mains courantes, afin que le lecteur n’ait pas l’impression d’avoir à gravir un mur. J’ai fini par me persuader que cela était nécessaire.
Pour en revenir à Claude Simon, je lui dois d’avoir compris en lisant L’acacia que l’on pouvait faire de la littérature avec des matériaux auto-biographiques. J’étais lourd de pareille matière mais n’en voyait partout que le morne déroulé du journal intime. Deux m’ont aidé de manière radicale. Simon, et Christa Wolf (avec Trames d’enfance). Mais je pourrais dire tout autant que j’ai longtemps été fasciné par les empâtements de l’une des premières périodes de Nicolas de Stael. Cette matière. Pour moi écrire est un geste délibérément matérialiste. Ce qui pourra sembler paradoxal à qui voit dans mon travail un souci permanent de spiritualité. Mais c’est peut-être cela la leçon d’Abraham : qu’il n’est rien de possible spirituellement qui ne s’empoigne avec la rudesse et la jouissance des matières.